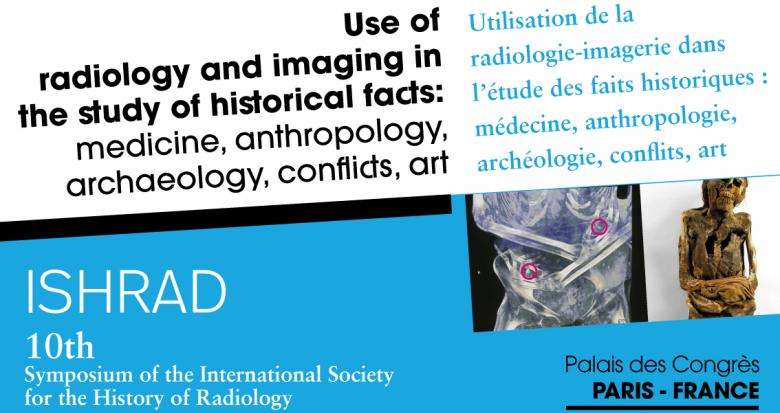Au retour d’une mission bénévole de 9 mois dans un dispensaire de brousse à Madagascar, envoyée par les Missions Etrangères de Paris, Anne Fustier nous fait part de cette expérience unique.
Arrivée au terme de mes études, après deux années d’assistanat suivies de deux années de PHC, j’ai souhaité faire une pause, sortir un peu la tête de l’hôpital, des vacations, de la course à la performance et à l’efficacité. Je rêvais de temps, de voyage et d’une belle aventure. Alors que je tergiversais depuis des mois sans trouver de projet satisfaisant, je me suis un jour souvenue que j’étais certes radiologue, mais aussi et avant tout médecin. À force de m’hyperspécialiser, je l’avais presque oublié.
Le hasard des rencontres a rapidement fait le reste ; un jour de mars 2015, j’ai appris qu’on me confiait la charge d’un dispensaire de brousse, dans le village de Bemaneviky, district du Haut-Sambirano, Madagascar. On m’enverrait en binôme avec une infirmière française ; nous trouverions sur place une jeune infirmière malgache fraîchement embauchée. Pas d’autre médecin, malheureusement : le dernier était parti un an auparavant et les successeurs ne se bousculaient pas au portillon, vu les conditions de vie locales.
Je voulais de l’exotisme, j’allais être servie ! Le Sambirano est un fleuve du nord de Madagascar, qui prend sa source dans le massif de l’Antsiranana et chemine sur une centaine de kilomètres avant de rejoindre le canal du Mozambique. Il irrigue une large et somptueuse vallée bordée de montagnes de faible altitude, où vivent plus de 150 000 habitants, dont la pauvreté est en grande partie liée à leur extrême isolement. En effet, le fleuve, peu profond, n’est navigable que quelques semaines par an et l’état de l’unique piste ralliant la route, désastreux. Quasiment tous agriculteurs, les habitants y cultivent le riz, le cacao, la vanille et le café et vivent dans un grand dénuement. Implantée depuis 35 ans au beau milieu de la vallée, la mission catholique Don Bosco de Bemaneviky y a fondé 9 écoles primaires de brousse, un collège-lycée, ainsi qu’un dispensaire médical. C’est là que j’ai travaillé bénévolement pendant 8 mois, aidée de deux infirmières. Mes débuts ont été laborieux et studieux : il me fallait raviver mes souvenirs cliniques, me familiariser avec les pathologies et médicaments locaux, sans autre outil paraclinique que des bandelettes urinaires, des tests de grossesse, un lecteur glycémique, mais surtout et heureusement, un échographe.

J’avais en effet apporté dans mes valises un échographe portable, gracieusement offert pour ma mission par le constructeur Esaote. Il m’est rapidement devenu indispensable, prolongeant mes mains et venant au secours de mon manque d’expérience clinique. Armée de trois sondes (microconvexe endocavitaire, convexe abdominale et linéaire 8-12 MHz), j’ai échographié mes patients sous toutes les coutures, sous leurs regards étonnés (ils n’avaient jamais rien vu de tel).
J’avais de la chance : leur maigreur habituelle les rendait parfaitement échogènes et ils n’avaient jamais de train à prendre. Attendre deux heures que le soleil brille suffisamment fort pour que je puisse démarrer mon échographe ne les dérangeait pas. Rentrer chez eux bredouilles les jours de pluie non plus, même s’il leur fallait plus de trois heures de marche pour venir au dispensaire (joies et peines des panneaux solaires…).
Hormis quelques clichés radiographiques dont le transport en charrette à zébu (version locale de l’ambulance), en pirogue ou à bicyclette ne m’avait pas laissé grand-chose d’interprétable, mon aire de jeu radiologique s’est donc limitée à mon seul échographe. Ce dernier a fait fureur auprès des femmes enceintes ; malheureusement le niveau de prise en charge obstétricale en brousse est tel que mes images ne furent pas d’une grande utilité. J’ai au moins savouré les regards ébahis et heureux des parents.

Sur le plan musculo-squelettique, les examens étaient moins joyeux, mais nettement plus utiles. J’ai pu délimiter et ponctionner des collections infectieuses des tissus mous et diagnostiquer des arthrites septiques secondaires à des plaies pénétrantes. La sonde abdominale m’a rendu de très bons services en cardiologie, me permettant de confirmer plusieurs insuffisances cardiaques, ou même de découvrir une impressionnante péricardite (tuberculeuse), que je n’ai pas eu le courage de ponctionner et qui s’en est tirée de justesse après un transfert chaotique en taxi-brousse. Mais c’est bien sûr en échographie abdomino-pelvienne que la rentabilité était la meilleure. Outre les pathologies habituelles de médecine de ville (sans les calculs vésiculaires ni l’athéromatose aorto-iliaque, rares chez ma patientèle), je me suis rapidement rendue compte que la vallée du Sambirano, parsemée d’innombrables rizières, ruisseaux et marigots, fourmillait de bilharzioses. Cette pathologie était si courante et si méconnue que la plupart des patients atteints ne me signalaient pas leur hématurie. Je découvrais le pot aux roses fortuitement à l’occasion d’une échographie abdominale. L’épaississement et les végétations de la paroi vésicale étaient bien visibles, plus ou moins pédiculées, de taille, degré de calcification et de vascularisation variables. L’atteinte rénale était moins évidente : dilatation pyélo-calicielle modérée, calcifications parenchymateuses ou calicielles infra-centimétriques.
Alertée, j’ai interrogé systématiquement mes patients en ce sens, confortant mon diagnostic grâce aux bandelettes urinaires apportées dans mes bagages et à l’échographie vésico-rénale pratiquée au moindre doute. J’ai été effrayée par le résultat : environ 20% de mes patients étaient probablement atteints de bilharziose, sur l’un de ces trois signes d’appel (hématurie macroscopique/microscopique/végétations vésicales pariétales).
Quelques-unes ont été confirmées biologiquement, lorsqu’un ECBU était réalisé au cours d’une hospitalisation. Le plus souvent, ce diagnostic fut rétrospectif : l’hématurie macroscopique cessait durant la semaine suivant le traitement, la bandelette se négativait en deux ou trois semaines ; l’amélioration échographique était nette après deux semaines, mais la disparition complète des végétations était plus variable, en fonction de leur taille. J’ai donc largement arrosé ma patientèle de praziquantel, consciente malheureusement de son éphémère efficacité en l’absence d’action d’envergure entreprise par les autorités sanitaires.

Les autres pathologies rencontrées étaient dominées par les maladies infectieuses, parasitaires ou non : diarrhées, infections sexuellement transmissibles, paludisme, tuberculose, infections dentaires, ORL ou pneumologiques. La dermatologie avait également la part belle, véritable défi pour moi ; j’ai régulièrement dû troquer mon échographe pour mon appareil photo et mettre à contribution mon réseau de correspondants via internet (chance inouïe, une antenne réseau avait été installée non loin du village quelques mois auparavant). J’ai aussi eu la chance de disposer d’une pharmacie, simple mais bien approvisionnée pour la région, que j’ai pu gérer à ma guise et qui m’a permis de traiter immédiatement mes patients lorsque c’était possible. Le manque de moyens se faisait tout de même sentir, nous imposant la devise « économie, recyclage, inventivité ». D’où des souvenirs plus ou moins cocasses, du tire-lait de fortune fabriqué dans l’esprit « entonnoir + pompe à vélo », à une fastidieuse entreprise de préparation de lait pour nourrisson dénutri avec les moyens du bord (à savoir pas grand-chose), en passant par une scène nocturne de cathétérisme sus-pubien olé-olé à lueur de frontale (pas de courant ? pas de sonde urinaire pédiatrique ? dommage !), j’en passe et des meilleures.

Au total, cette expérience fut extrêmement épanouissante. J’ai pu constater la formidable utilité de l’échographie en médecine de brousse, ainsi que sa faisabilité. Ma machine a résisté à plusieurs jours de transport par 35°C sur des pistes défoncées, puis à l’extrême humidité de la saison des pluies. Même les rats, qui ont pourtant saccagé à plusieurs reprises ma pharmacie (je retrouvais leurs cadavres à côté de tablettes de médicaments vides !), ont épargné les câbles de mon échographe. Je reviens convaincue de l’intérêt de la pratique échographique en médecine humanitaire. De nombreuses actions sont réalisables à Madagascar, qu’il s’agisse de dotation de matériel, de formation des médecins locaux, ou de missions ponctuelles d’échographie.
Je ne nierai pas que le sentiment d’impuissance a souvent accompagné mon quotidien, parfois douloureusement dans les cas sévères, d’autant plus lorsqu’il s’agissait d’enfants ou de pathologies curables en France. Mais la joie des quelques victoires remportées est si grande qu’elle efface l’ardoise. Le vertigineux décalage social et économique m’a parfois donné le sentiment d’être perdue sur une autre planète ou à une autre époque, mais m’a offert un recul profondément libérateur sur ma vie et notre société. Et surtout, j’ai fait en cette contrée lointaine des rencontres merveilleuses, édifiantes, qui marqueront ma vie à jamais. Les voyages forment la jeunesse, n’est-ce pas ?
Anne Fustier
Radiologie polyvalente, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris